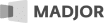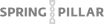En 2024, et pour la deuxième année consécutive, l’agence de branding et naming Labbrand a lancé Vocaliz, son concours étudiant de création de mots nouveaux. Cette année, plus de 100 étudiants issus de 30 écoles ont relevé le défi d’inventer des néologismes pour raconter leur époque, leur quotidien, leurs émotions.
Les équipes Naming et Études de Labbrand ont analysé l’ensemble des propositions pour mieux cerner les préoccupations, espoirs et réflexions de la GenZ.
Si la première édition révélait une jeunesse engagée sur les grands défis sociétaux — paix (Pacifester), nature (Célestaquie), écologie (Écobiocratie) — cette année marque un tournant. Une introspection plus intime émerge, traduisant une quête de refuge(s) que nous vous invitons à explorer.
Une ambiance teintée d’anxiété

En dehors de la parenthèse estivale enthousiaste des Jeux Olympiques de Paris, l’année 2024 a été marquée par une accumulation de crises et de bouleversements en France et dans le monde : instabilité politique, tensions géopolitiques, conflits militaires, dérèglement climatique, crises économiques et sociales
Dans ce contexte chargé, on aurait pu s’attendre à ce que les néologismes créés par les étudiants traduisent nos crises globales. Dans les faits, peu de noms évoquent directement les grands bouleversements du monde, mais à l’échelle individuelle, les néologismes et définitions révèlent néanmoins une morosité diffuse. Dès la lecture, une ambiance sombre, pesante et triste se dégage, avec des termes comme stress, angoisse, obscurité, cécité, peur… qui apparaissent en filigrane dans de nombreuses créations. Face à un monde qui leur échappe, les étudiants ressentent fortement l’angoisse et le stress.
Le mot « Serourgor », par exemple, exprime cette angoisse qui prend à la gorge : il signifie « quand on a le cœur serré par de l’angoisse ou du stress », jusque dans ses sonorités oppressantes.
Le stress se reflète aussi dans le rythme quotidien, les études,…comme « Dimesse » , « combinaison de « dimanche » (dim) et « tristesse » (esse) » qui exprime le « Sentiment de grande tristesse le dimanche soir quand on sait que le lendemain (le lundi) approche et qu’on ne veut pas aller en cours. »
D’autres mots traduisent une tentative de contrôle face à cette anxiété. Ansi « Rectanxie » « cherche à « rectifier » pour apaiser son angoisse ». « Cela se traduit par un besoin compulsif de tout ranger, nettoyer et remettre en ordre, comme un moyen de se libérer d’un sentiment d’anxiété ».
Ces créations montrent que, même dans l’intimité, les jeunes cherchent à apprivoiser leurs angoisses.
Perdre la notion du temps, un refuge numérique

Décrit comme « un refuge face à la complexité du monde », le numérique et les réseaux sociaux apparaissent comme une échappatoire rapide et accessible pour se couper du monde, du bruit et s’immerger dans une « bulle ». Plus qu’un espace d’ouverture aux autres ou à la société, ils sont perçus comme un moyen de s’isoler, de se mettre à distance du vacarme du monde réel et des interactions directes. Cette tendance est illustrée par « Silencophonie », qui désigne « l’habitude de communiquer en silence, via des messages écrits ou des emojis, sans échanger un mot à l’oral ». Le digital permet une errance passive et réconfortante, sans attente, résumée par « Netinerte » : l’inertie volontaire sur internet.
Mais si cette bulle personnelle apporte du réconfort, les étudiants en soulignent aussi ses limites avec lucidité.
D’abord ils pointent le risque d’isolement, d’enfermement, la peur de passer à côté de moments ou d’événements de la vie réelle. Le mot « Ecranivoire » illustre cette ambivalence, décrivant une « émotion proche de la culpabilité, lorsque, « le refuge, se transforme en piège dans lequel on s’enferme volontairement, coupé du réel, en dehors du temps ». Une fois sortis de cette bulle, les étudiants peuvent ressentir une forme de regret, la sensation d’avoir manqué quelque chose dans le réel : un moment, une personne, une interaction.
Ils soulignent aussi que cette bulle, aussi apaisante soit-elle en apparence, ne résout pas tout. Parfois, elle devient même source d’inconfort. Parce qu’elle échappe en partie ou totalement au contrôle de l’utilisateur, elle expose à des situations troublantes, comme « Intimuation », « mélange d’intime » et « suggestion » », « quand un algorithme de suggestion nous recommande quelque chose qui semble beaucoup trop personnel ou précis ».
Enfin, cette immersion digitale peut accentuer un sentiment de mélancolie, voire de tristesse, comme le décrit « Tristofilage »: « l’habitude de faire défiler sans fin des nouvelles ou des publications sur les réseaux sociaux déprimantes ou négatives, ce qui entraîne un sentiment de tristesse grandissant »
Entre refuge et piège, le numérique apparaît ainsi comme un espace paradoxal : un havre rassurant, mais aux contours flous, où la quête de répit peut parfois se retourner contre ceux qui s’y abandonnent trop longtemps.
Remonter le temps, un refuge nostalgique
Les néologismes de cette année mettent en lumière un refuge particulièrement prisé par les étudiants : la nostalgie. Face à un monde qui leur échappe, ils se tournent vers leur sphère intime et émotionnelle pour y trouver apaisement et réconfort. Cette quête de souvenirs doux et rassurants se traduit dans des créations comme « Nostrêve », « une fusion de « nostalgie » et « rêve » ».
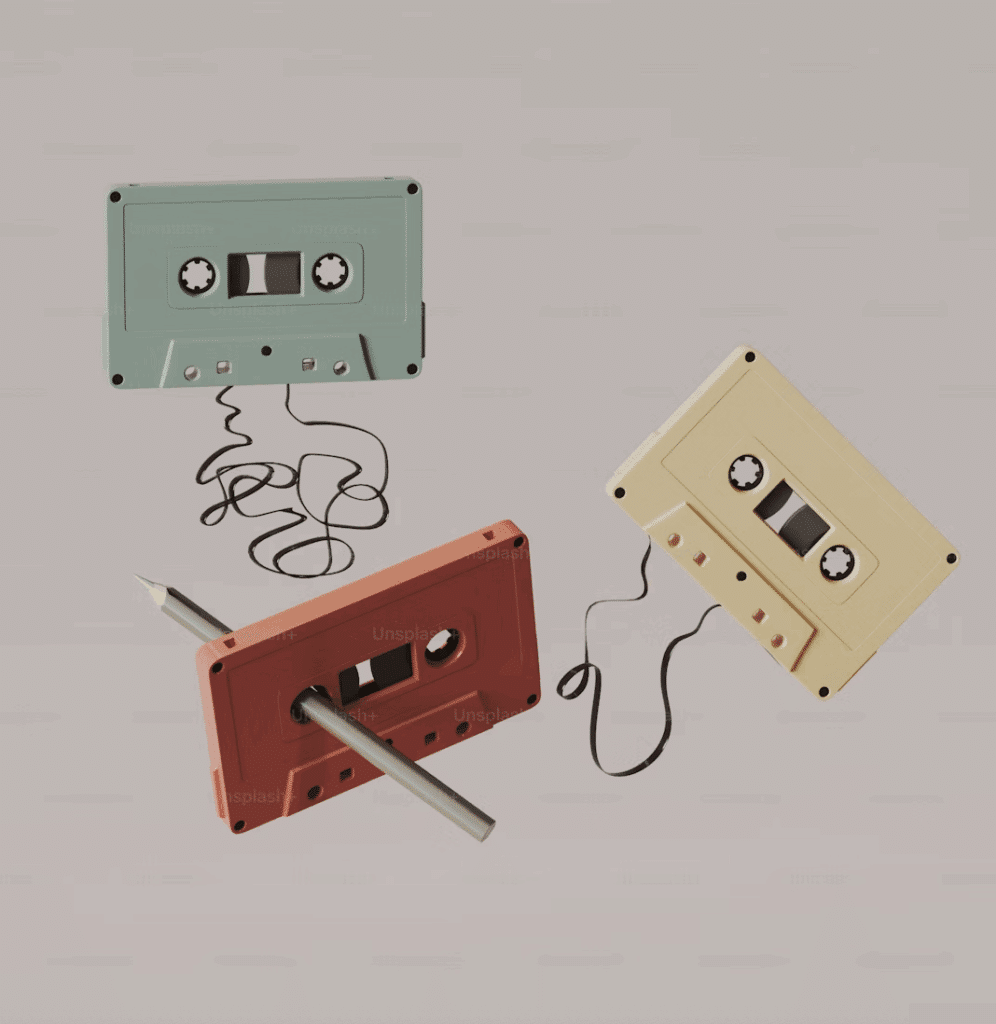
La nostalgie est principalement liée au réconfort qu’apporte le fait de remonter le temps, de se plonger dans les souvenirs de choses perdues ou éloignées du « soi » d’aujourd’hui. C’est un sentiment qui évolue et se transforme, comme l’illustre « Spleenescence », décrit comme « un processus dans lequel le spleen, mélancolie profonde, se transforme lentement en un sentiment de douceur, un état d’apaisement où les souvenirs heureux deviennent une source de réconfort ».
Ces souvenirs des jours heureux deviennent ainsi des refuges mentaux, des ancrages émotionnels permettant de se protéger du stress, de l’anxiété ou de la fatigue. Et, à un âge où les responsabilités des jeunes adultes ne font que grandir, il est logique que l’insouciance de l’enfance soit un repère vers lequel ils reviennent instinctivement.
Cette nostalgie est exprimée avec humour et autodérision, comme dans « Enstalgie » : « C’est la nostalgie de l’enfance. C’est l’émotion que l’on ressent quand on se rend compte que les responsabilités d’adulte c’est sympa, mais sympa avant de devoir te cuisiner 3 repas par jour et suivre ta consommation d’électricité de près. C’est ce qui nous rappelle que finalement, quand on avait 4 ans et qu’on avait le cœur déchiré parce que le goûter du voisin était meilleur, c’était pas si mal ».
Et cette nostalgie apaisante est très largement associée à des souvenirs « simples », des temps heureux accessibles et loin de tout faste. C’est ainsi que ces sentiments peuvent se cristalliser autour d’une idée de nature ; le souvenir de paysages loin de l’urbanisme quotidien « Montalgie » : « C’est ressentir de la nostalgie des moments de connexion avec les montagnes » » ou encore la volonté de retrouver la douceur de l’été, « Solasme » : « Sentiment mélancolique provenant d’un désir accru de retrouver l’été ».
Les souvenirs peuvent également être sensoriels, activant la mémoire gustative ou olfactive. L’effet madeleine de Proust se traduit dans des mots comme « Foodstalgique », qui évoque la nostalgie d’un goût particulier, ou « Mémodora », qui illustre le pouvoir évocateur des odeurs pour faire ressurgir des souvenirs enfouis.
Enfin, la nostalgie peut aussi s’inscrire dans son sens étymologique premier – celui du mal du pays. Elle résonne particulièrement chez les étudiants étrangers ou binationaux, dont les repères culturels et linguistiques sont en perpétuelle réinvention dans un monde globalisé, comme l’illustre « Frûnglais ».
Ce tiraillement identitaire s’exprime avec poésie dans « Exilémie », défini comme « le paradoxe émotionnel d’un expatrié : Un mélange de joie et de nostalgie dans sa nouvelle vie tout en ressentant un lien émotionnel profond avec ses racines » (1er prix du concours 2024).
Ainsi, cette nostalgie n’est pas seulement un regard tourné vers le passé, mais un refuge, une manière pour les étudiants d’ancrer leur identité et de trouver du sens dans un monde en perpétuel changement.
Suspendre le temps, un refuge onirique
En parallèle des refuges numériques et nostalgiques qui chacun à leur manière, offrent aux étudiants la possibilité de se créer une bulle réconfortante, une autre forme de refuge émerge : celle du sommeil et des rêves. Ici, c’est une échappée vers l’imaginaire, où la poésie et l’onirisme ouvrent des portes vers un ailleurs apaisant.
Par nature, le sommeil symbolise l’apaisement et le repos, tandis que les rêves, en s’opposant à la réalité, permettent de mettre à distance le monde extérieur. Le lit et le plaid deviennent des incarnations du cocon : un abri dans lequel on se sent en sécurité sans conditions.

Dans cet espace suspendu, les étudiants trouvent un sanctuaire ou laisser leur esprit vagabonder librement. Cet état transitoire, entre éveil et sommeil, est à la fois agréable et apaisant si bien qu’ils cherchent parfois à l’étirer, à en savourer chaque instant.
C’est ce que traduit « Retamorpher », défini comme « Retarder, à outrance, le moment du réveil. Il est possible de retamorpher après une nuit ou simplement après une sieste dont il est difficile de sortir. Beaucoup d’individus retamorphent pour éviter d’affronter un monde extérieur qui leur parait anxiogène »(3eme prix concours Vocaliz)
Ce désir de prolonger l’instant du refuge se retrouve aussi dans des gestes simples, comme s’enrouler dans un plaid et se couper du monde, illustré par « Plaidamiser » : « Inspiré du mot plaid. Il signifie s’enrouler dans un plaid, c’est-à-dire prendre un plaid et se cacher dedans en ne laissant voir que le visage, sans rien faire de la journée ».
Mais si cet univers onirique offre un répit, il est aussi teinté d’ambivalence. La réalité, bien que tenue à distance, reste en arrière-plan, et l’éveil marque un retour parfois brutal à un quotidien moins enchanteur. C’est cette transition qui donne naissance à « Mélonirie », décrite comme « cette mélancolie douce qui survient à chaque réveil d’un beau rêve, lorsque la réalité semble fade comparée à l’intensité de ce qu’on vient de vivre. La mélonirie est cette tristesse légère d’une expérience éphémère que nous avons uniquement vécue en rêve ».
Enfin, certains néologismes traduisent une aspiration plus profonde au bonheur, mêlant rêve et mélancolie dans une quête presque inaccessible, comme « Solitasre », qui évoque « un sentiment mélancolique mélangé à la rêverie qui évoque un désir d’être heureux «
Ainsi, l’univers du sommeil et des rêves se révèle être bien plus qu’un simple refuge : c’est un espace de transition entre la réalité et l’imaginaire.
Des refuges comme temps de réflexion
Si, comme nous l’avons vu, les créations linguistiques des participants traduisent une recherche de refuges pour se protéger d’un quotidien perçu comme pesant, ces moments d’introspection ne se limitent pas à une fuite passive. Ils deviennent souvent un espace où germe une réflexion plus profonde, une prise de conscience, et parfois même une étincelle d’inspiration. Ces refuges ne sont donc pas synonymes d’inaction, mais bien de temps suspendu, propice à l’élaboration de nouvelles idées ou à une meilleure compréhension de soi.
Dans ces instants de recul, le processus mental devient un véritable laboratoire intérieur où pensées, émotions et sentiments s’entrelacent pour donner naissance à une fulgurance, un éclair de créativité ou de clarté. C’est ce que traduit « Tempéclat » : « Un moment instable où l’on se sent envahi par une grande clarté mentale ou une profonde inspiration, comme un éclair de créativité surgissant au milieu d’une réflexion confuse. ». Cette dynamique d’exploration se retrouve aussi dans « Memimprospection » : qui « Désigne l’action de stimuler une réflexion approfondie (et sa mémoire) de manière originale. Ce terme s’inspire de l’idée de sortir des schémas de pensée habituels, en encourageant une introspection ou une réflexion plus élaborée, au-delà des considérations de base. »

A ces élans s’ajoute « Éclairnote », « Un mélange de éclair et note, décrivant une pensée soudaine ou une idée qui semble urgente et importante, incitant souvent quelqu’un à la noter rapidement avant de l’oublier. C’est un petit « éclair » mental qui surgit de nulle part, souvent à des moments inopportuns, comme lorsqu’on s’endort ou sous la douche. »
Ces instants d’évasion intellectuelle permettent aussi de prendre du recul sur le ressenti immédiat, en explorant les multiples facettes des émotions et des situations.
« Miores » illustre cet « état mental dans lequel pensées, émotions et sentiments se croisent et créent une entropie sentimentale dont on devient conscient, permettant une réflexion plus poussée. »
De la même manière,« Prismalité » traduit la « Capacité à percevoir une situation sous plusieurs angles simultanément, comme à travers un prisme, révélant les multiples facettes et nuances d’une réalité complexe. »
Enfin ces refuges sont également le terreau d’un dialogue intérieur et extérieur enrichissant. Même dans l’échange avec autrui, l’objectif n’est pas de convaincre, mais d’apprendre et d’évoluer ensemble. C’est tout le sens de « Chilloguer » « débattre non pas pour convaincre l’autre, mais pour avancer ensemble. L’objectif de chilloguer serait de sortir de la discussion en ayant enrichi son opinion d’un aspect de la réflexion d’autrui. »
Ainsi, derrière la quête d’un abri se cache une dynamique plus ambitieuse : celle de transformer ces moments d’isolement ou de pause en un élan porteur de solutions, d’introspection et d’enrichissement personnel. En se perdant en soi-même, les étudiants montrent qu’ils cherchent, au fond, à mieux se retrouver, et à avancer vers une lumière porteuse d’espoir.
L’IA : un outil fonctionnel dans ce nouveau paradigme
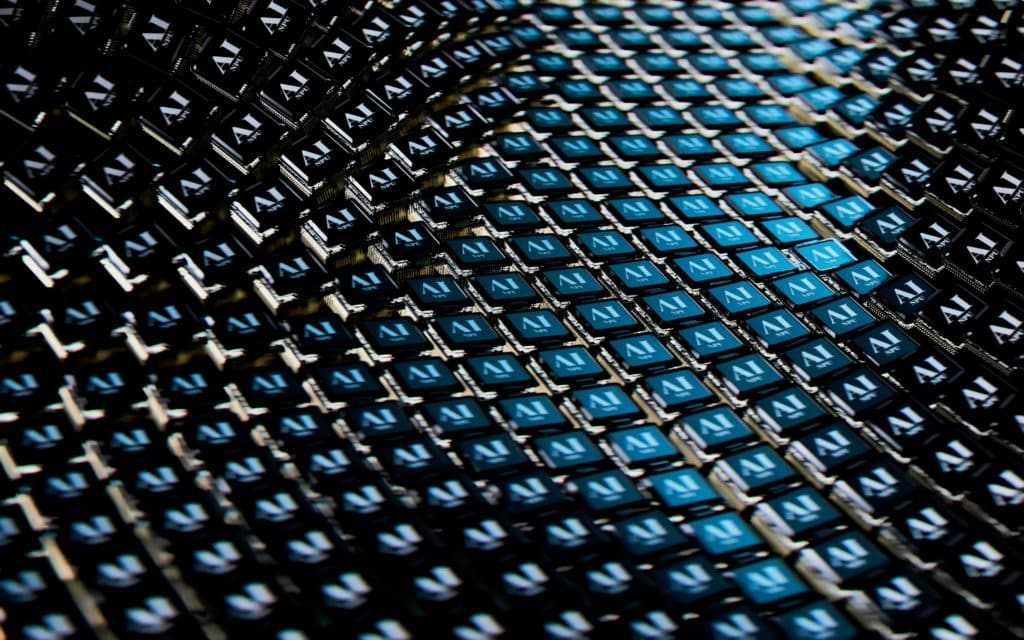
Dans ce paradigme d’introspection et de recherche de solutions, l’intelligence artificielle s’impose comme un levier pragmatique, un outil fonctionnel au service des aspirations des étudiants.
Elle n’est ni refuge, ni source d’émotion, mais un moyen efficace de créer, de Son utilisation se normalise, notamment à travers « Rédiager », (deuxième prix concours Vocaliz) qui désigne tout simplement le fait d’utiliser l’IA pour rédiger un texte. De manière plus large, « E-générationner » illustre l’usage des IA génératives pour la rédaction ou la création de contenu, soulignant leur rôle croissant dans le processus créatif. Quant à « Novamorphia », il exprime la capacité de l’intelligence artificielle à générer ou transformer de nouvelles formes, offrant ainsi un champ d’exploration infini.
Loin d’être un simple gadget, l’IA s’intègre comme un amplificateur de productivité, un allié du quotidien qui permet d’optimiser le temps et l’énergie, des ressources devenues plus précieuses que jamais.
Conclusion : de l’ombre vers la lumière
Cette 2ème édition de VOCALIZ par LABBRAND offre une formidable fenêtre sur l’état d’esprit de la Gen Z. Sous l’apparence de replis numériques, nostalgiques, oniriques ou intellectuels, ces néologismes traduisent une quête de clarté, une volonté de s’extraire de la morosité pour mieux réfléchir, se retrouver et avancer vers des solutions.
Une lumière discrète qui fait bouger notre vision du monde de demain !
Merci à tous les participants de cette cuvée Vocaliz 2024. Pour télécharger le dico des mots nouveaux 2024, cliquez ici.
Rendez-vous en Octobre 2025 pour la 3ème édition